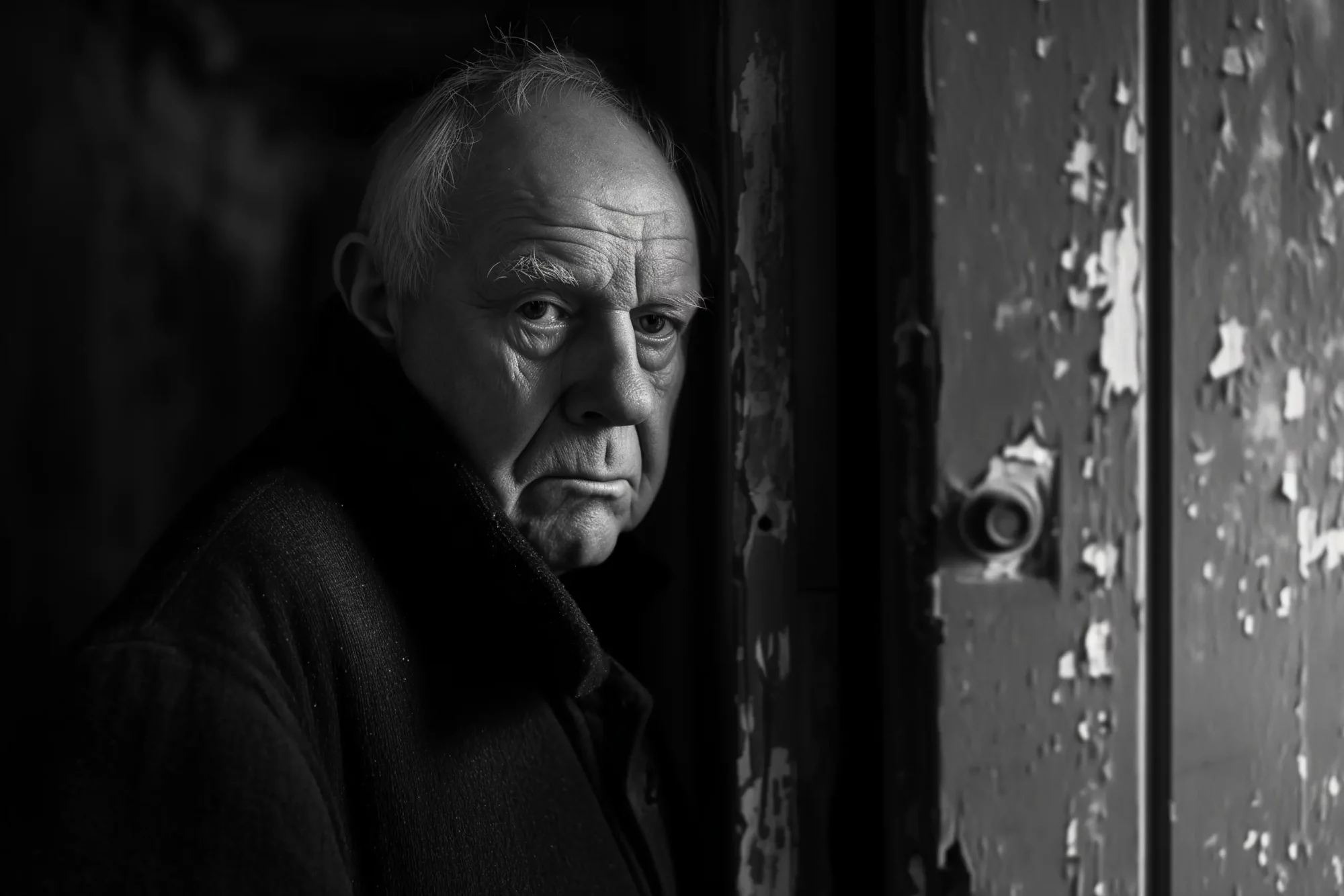La Nouvelle Vague, ou « Nouvelle Vague », est un mouvement cinématographique français apparu à la fin des années 1950. Il a perduré jusqu’à la fin des années 1960. Ce courant a profondément transformé le paysage du cinéma mondial en introduisant de nouvelles approches narratives et esthétiques.
La Nouvelle Vague émerge dans un contexte de remise en question du cinéma traditionnel français, souvent qualifié de « cinéma de papa ». Les jeunes cinéastes de l’époque, pour la plupart critiques au sein de la revue Cahiers du cinéma, reprochent à ce cinéma sa rigidité et son manque d’innovation. Parmi eux, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol et Jacques Rivette se distinguent par leur désir de renouveler le langage cinématographique.
Une Vague de nouveautés
Les réalisateurs de la Nouvelle Vague prônent une approche plus libre et personnelle du cinéma. Ils favorisent le tournage en extérieur, l’utilisation de la lumière naturelle et des acteurs non professionnels. Leur style se caractérise par des techniques innovantes. Le montage peut-être discontinu, les plans-séquences et une narration non linéaire sont utilisés. Cette approche vise à refléter une réalité plus authentique. Il s’agit impliquer davantage le spectateur dans le récit.
Des films emblématiques
- Les Quatre Cents Coups (1959) de François Truffaut : Ce film autobiographique raconte l’histoire d’Antoine Doinel, un adolescent en rébellion contre l’autorité. Il est considéré comme l’un des premiers films de la Nouvelle Vague et a remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.
- À bout de souffle (1960) de Jean-Luc Godard : Avec son style novateur, notamment l’utilisation de jump cuts, ce film suit les errances d’un jeune criminel et de sa petite amie américaine dans les rues de Paris.
- Cléo de 5 à 7 (1962) d’Agnès Varda : Ce film suit en temps réel une chanteuse attendant les résultats d’un examen médical, offrant une réflexion profonde sur la vie et la mortalité.
Des héritiers et une influence considérable
La Nouvelle Vague a eu un impact durable sur le cinéma mondial. Elle a inspiré de nombreux mouvements cinématographiques, notamment le Nouvel Hollywood aux États-Unis, et a ouvert la voie à une plus grande liberté artistique pour les réalisateurs. Aujourd’hui encore, son influence se fait sentir.
La Nouvelle Vague a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma contemporain, influençant aussi bien les réalisateurs indépendants que les productions grand public. Ses innovations stylistiques et narratives se retrouvent dans de nombreux films, qu’ils soient hollywoodiens, européens ou asiatiques. Voici quelques aspects clés de cette influence, illustrés par des exemples concrets.
Pour une approche libre et réaliste du tournage
La Nouvelle Vague a popularisé le tournage en extérieur avec des moyens légers, l’utilisation de la lumière naturelle et des caméras portatives. Cette approche continue d’inspirer les cinéastes contemporains, notamment dans le cinéma indépendant.
- Exemple : Frances Ha (2012) de Noah Baumbach
Ce film, tourné en noir et blanc avec une caméra mobile et un budget réduit, rappelle fortement l’esthétique des films de la Nouvelle Vague, notamment ceux de Truffaut et Rohmer. - Exemple : Moonlight (2016) de Barry Jenkins
L’utilisation d’une lumière naturelle, de décors réels et d’un style proche du documentaire évoque le réalisme et l’intimité que la Nouvelle Vague cherchait à atteindre. - Exemple : Richard Linklater
Son film Before Sunrise (1995) suit deux personnages se promenant et conversant à Vienne, dans un style proche de Cléo de 5 à 7 (1962) d’Agnès Varda, qui suit une femme errant dans Paris en temps réel. - Exemple : Alfonso Cuarón
Dans Children of Men (2006) et Roma (2018), Cuarón emploie de longs plans-séquences en caméra portée, rappelant la fluidité du style de François Truffaut dans Les Quatre Cents Coups (1959).
Montages audacieux et innovants
Le mouvement a bouleversé les règles du montage classique avec des techniques comme le jump cut, les ruptures temporelles et les narrations non linéaires. Il s’agissait de défier les conventions, notamment par une mise en abyme du processus cinématographique.
- Exemple : Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino
La structure fragmentée du film, qui déconstruit la chronologie du récit, s’inscrit dans l’héritage de la Nouvelle Vague et des expérimentations de Godard (À bout de souffle). - Exemple : The Social Network (2010) de David Fincher
Le film utilise des allers-retours constants entre différentes temporalités, une technique largement inspirée des narrations déconstruites chères à Alain Resnais (Hiroshima mon amour). - Exemple : Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) de Michel Gondry
Son film joue avec le temps, la mémoire et les conventions narratives, une approche qui rappelle les expérimentations formelles de Godard ou Resnais (Hiroshima mon amour, 1959).
Jouer avec les codes du récit et de la mise en scène
Les réalisateurs de la Nouvelle Vague ont souvent brisé le quatrième mur, commenté leurs propres films ou joué avec l’attente du spectateur.
- Exemple : Birdman (2014) de Alejandro G. Iñárritu
L’illusion d’un plan-séquence unique qui compose tout le film, ainsi que les moments où le personnage principal dialogue avec lui-même ou interagit avec la caméra, rappellent la spontanéité et la liberté de mise en scène que Godard et Varda affectionnaient. - Exemple : The French Dispatch (2021) de Wes Anderson
La narration éclatée en plusieurs histoires, l’usage de la voix off et l’hommage appuyé aux films de Truffaut et Godard témoignent de l’influence directe du mouvement sur l’esthétique d’Anderson.
Des personnages en quête d’identité
La Nouvelle Vague a mis en avant des personnages marginaux, en rupture avec la société ou en quête de sens.
- Exemple : Frances Ha (2012) de Greta Gerwig
Co-réalisé avec Noah Baumbach, Gerwig met en scène une héroïne en errance, cherchant sa place dans le monde, dans un noir et blanc qui évoque le cinéma de la Nouvelle Vague.
L’essor du cinéma d’auteur
La Nouvelle Vague a contribué à l’émergence du cinéaste-auteur, où le réalisateur impose sa vision personnelle plutôt que de suivre un cahier des charges dicté par les studios. Aujourd’hui, de nombreux réalisateurs adoptent cette posture.
- Exemple : Xavier Dolan (Mommy, 2014)
L’approche très personnelle de Dolan, sa mise en scène stylisée et son attention aux relations humaines rappellent le travail d’auteurs comme Truffaut. - Exemple : Joachim Trier (Julie en 12 chapitres, 2021)
Son usage des monologues internes, des ruptures narratives et du style naturaliste renvoie aux films introspectifs de la Nouvelle Vague.
La Nouvelle Vague a profondément marqué le cinéma en brisant les règles du récit et de la mise en scène classiques. L’héritage de la Nouvelle Vague est omniprésent dans le cinéma moderne, influençant aussi bien la narration que la mise en scène et la production. Son esprit de liberté continue d’inspirer de nouveaux cinéastes, prouvant que l’audace et l’expérimentation restent essentielles pour renouveler le langage cinématographique.